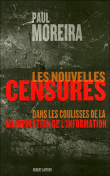Les stratégies et techniques employées pour la manipulation de l’opinion publique et de la société.
|1| La stratégie de la diversion
Elément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l’attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et d’informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s’intéresser aux connaissances essentielles, dans les domaines de la science, de l’économie, de la psychologie, de la neurobiologie, et de la cybernétique. "Garder l’attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, occupé, occupé, sans aucun temps pour penser ; de retour à la ferme avec les autres animaux." (extrait de "Armes silencieuses pour guerres tranquilles")
|2| Créer des problèmes, puis offrir des solutions
Cette méthode est aussi appelée "problème-réaction-solution". On crée d’abord un problème, une "situation" prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu’on souhaite lui faire accepter. Par exemple : laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore : créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics.
|3| La stratégie du dégradé
Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l’appliquer progressivement, en "dégradé", sur une durée de 10 ans. C’est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisations, salaires n’assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution si ils avaient été appliqués brutalement.
|4| La stratégie du différé
Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme "douloureuse mais nécessaire", en obtenant l’accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d’accepter un sacrifice futur qu’un sacrifice immédiat. D’abord parce que l’effort n’est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que "tout ira mieux demain" et que le sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s’habituer à l’idée du changement et l’accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. Exemple récent : le passage à l’Euro et la perte de la souveraineté monétaire et économique ont été acceptés par les pays Européens en 1994-95 pour une application en 2001. Autre exemple : les accords multilatéraux du FTAA que les USA ont imposé en 2001 aux pays du continent américain pourtant réticents, en concédant une application différée à 2005.
|5| S’adresser au public comme à des enfants en bas-âge
La plupart des publicités destinées au grand-public utilisent un discours, des arguments, des personnages, et un ton particulièrement infantilisants, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas-age ou un handicapé mental. Exemple typique : la campagne TV française pour le passage à l’Euro ("les jours euro"). Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ? "Si on s’adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celles d’une personne de 12 ans." (cf. "Armes silencieuses pour guerres tranquilles")
|6| Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion
Faire appel à l’émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l’analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus. De plus, l’utilisation du registre émotionnel permet d’ouvrir la porte d’accès à l’inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements...
|7| Maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise
Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. "La qualité de l’éducation donnée aux classes inférieures doit être de la plus pauvre sorte, de telle sorte que le fossé de l’ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures." (cf. "Armes silencieuses pour guerres tranquilles")
|8| Encourager le public à se complaire dans la médiocrité
Encourager le public à trouver "cool" le fait d’être bête, vulgaire, et inculte...
|9| Remplacer la révolte par la culpabilité
Faire croire à l’individu qu’il est seul responsable de son malheur, à cause de l’insuffisance de son intelligence, de ses capacités, ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l’individu s’auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l’un des effets est l’inhibition de l’action. Et sans action, pas de révolution !...
|10| Connaître les individus mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes
Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, et la psychologie appliquée, le "système" est parvenu à une connaissance avancée de l’être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l’individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes.
Source
Manipulation de l'opinion, mode d'emploi
-
tristesir
Manipulation de l'opinion, mode d'emploi
Un petit texte trouvé sur le web:
-
gaia
-
marry13
Nous avons les mêmes lectures, et je compte bien l'acheter ce bouquin dès sa parution, l'article de Marianne m'a mis l'eau à la bouche... mais m'a bien mise aussi en rogne, même si je sais pertinemment qu'on nous ment en permanence sur tout et sur rien. Il ne faudrait jamais regarder la télé, en particuliers les journaux télévisés -ce que j'ai naturellement tendance à faire d'ailleurs, tellement j'en ai marre d'entendre parler des soldes, de la neige, des ragnagna de bobonne et du chien-chien de Ducon, pour faire diversion sur ce qu'on nous prépare dans notre dos et des horreurs qu'on laisse se perpétrer dans le monde...gaia a écrit :il y a un article sur la desinformation dans marianne n 510, ils font référence à un livre de paul moreira qui parle du role des fabriques d'intox : "les nouvelles censures. Dans les coulisses de la manipulation" de paul moreira ed laffont à paraitre le 5 février
-
St-Dumortier
Bonjour,
A voir mercredi 31 janvier sur Arté:
La langue ne ment pas
Réalisateur: Stan Neumann
"L'humeur Vagabonde".
si j'en crois les nombreux messages traitants de la désinformation et du matraquage idéologique par le vocabulaire utilisé ...
A voir mercredi 31 janvier sur Arté:
La langue ne ment pas
Réalisateur: Stan Neumann
Perso je verrais pas (sauf si quelqu'un trouve un lien), mais j'ai écouté une chronique sur France inter ce soir :L'imprégnation de l'idéologie nazie dans la langue allemande à travers le journal du linguiste juif Victor Klemperer. Une chronique de la violence quotidienne et un point de vue sur un aspect particulier de l'oppression nazie.
"L'humeur Vagabonde".
Sujet de circonstanceDe 1933 à 1945, Viktor Klemperer tiendra son journal dans lequel il étudiera avec finesse, humour et rigueur, ce qu'il appellera la LTI, Ligua Tercii Imperii, la langue du troisième Reich. Chaque jour il note les mots nouveaux qui apparaissent comme le détournement du sens de mots anciens, les euphémismes et les superlatifs qui fabriquent une langue nazie qui sera vite partagée par tous, bourreaux comme victimes.
si j'en crois les nombreux messages traitants de la désinformation et du matraquage idéologique par le vocabulaire utilisé ...
-
tristesir
Exemple qui s'est généralisé: "charges sociales" en lieu et place de "cotisations sociales".Sujet de circonstance
si j'en crois les nombreux messages traitants de la désinformation et du matraquage idéologique par le vocabulaire utilisé ...
A chaque fois que quelqu'un utilise l'expression "charges sociales" il retransmet à son insu (ou pas, parfois) le sens que génère cette expression.
Ou bien "bénéficiaires des minimas sociaux" en lieu et place de "assujettis aux minimas sociaux" qui traduit mieux la situation de beaucoup de gens et ne retransmet pas l'idée qu'ils ne sont que de vils profiteurs.
-
St-Dumortier
-
tristesir
www.penombre.orgL'association Pénombre propose un espace public de réflexion et d'échange sur l'usage du nombre dans les débats de société: justice, sociologie, médias, statistiques.
(du mauvais usage des nombres par les politiciens et autres démagogues appliqué à la manipulation de masse. Ca c'est moi qui le rajoute)
Extrait:
Le chomâge des jeunes: un sur quatre ou un sur douze?
On entend encore dire régulièrement, y compris de sources « autorisées », qu’un jeune sur quatre serait au chômage. Cette affirmation a été maintes fois démentie, preuves à l’appui… mais elle a la vie dure !
Admettons qu’on soit d’accord:
- sur le champ géographique (la France métropolitaine),
- sur la population concernée : les personnes résidentes (en France métropolitaine, donc) et non pas, par exemple, les personnes possédant la nationalité française.
- sur « l’erreur admissible » : en dessous de 22,5 %, on devrait dire « un sur cinq » ; au-dessus de 29,1 %, on devra dire un sur trois ; on pourrait être plus sévère en considérant qu’au-dessus de 27,5 % on arrondirait plutôt à « 3 sur 10 » qu’à un sur quatre, mais soyons magnanimes : gardons cette fourchette large, de 22,5 à 29,1 %.
Ceci étant admis, il ne resterait plus qu’à s’entendre sur deux définitions : celle du jeune et celle du chômage. C’est apparemment le plus simple, mais c’est pourtant là que le bât va blesser…
Le jeune, d’abord. La définition qu’on en donnera spontanément est certainement très variable selon l’âge de l’observateur - on parle de « jeunes retraités » - et de sa position sociale - pour un sénateur, le « jeune » est un moins de 35 ans, non éligible à la Chambre haute ! Si on s’en tient aux moins de 30 ans, il y a au moins trois « seuils supérieurs », chacun d’entre eux pouvant de plus être dédoublé selon que l’on inclut ou non la borne supérieure : 20 (ou 19) ans, 25 (ou 24) ans et 30 (ou 29) ans. On rencontre d’ailleurs ces trois seuils, sans sortir du site internet de l’Insee. Retenons 25, borne supérieure exclue, soit les « 24 ans ou moins », ceux qui n’ont pas encore atteint leur 25ème anniversaire. Ceci conduit à admettre - avec quelque réticence pour le quinquagénaire que je suis - que la jeunesse s’envole le jour du 25ème anniversaire de l’intéressé. Et tout en étant conscient que la population des 20-24 ans et celle des 25-29 ans sont certainement très différentes, fort distinctes de celle des « moins de 20 ans », et certainement elles-mêmes très hétérogènes. Et non sans observer, et s’émouvoir un peu en tant que citoyen, que l’âge de la majorité légale n’est apparemment nulle part retenu comme seuil pertinent.
Le chômage ensuite. L’Insee le définit ainsi : « Le chômage représente l’ensemble des personnes en âge de travailler (15-74 ans(1)), privées d’emploi et en recherchant un ». L’Institut ajoute : « Sa mesure est complexe. Les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont pas toujours faciles à établir. Il y a en France deux sources statistiques principales sur le chômage : les statistiques mensuelles du ministère du Travail, élaborées à partir des fichiers de demandeurs d’emploi enregistrés par l’ANPE, et l’enquête emploi de l’Insee, qui mesure le chômage au sens du BIT». On parle bien de deux sources « principales ». En effet, on pourrait au moins en citer une troisième : le recensement de la population, également effectué sous l’autorité technique de l’Insee(2). Retenons la définition « au sens du Bureau international du travail ». Tout en étant conscient que ce seul point soulève des objections et nourrit de vastes débats. Pour ne citer qu’un exemple : une personne ayant travaillé une heure au cours de la semaine précédente n’est pas considérée comme chômeuse « au sens du BIT ».
Avec ces deux définitions du jeune et du chômage, il y aurait environ 650 000 chômeurs de 24 ans ou moins. On peut donc déjà apprécier l’affirmation « un jeune de moins de 25 ans sur quatre est au chômage » si on connaît le nombre de « moins de 25 ans » résidant en France métropolitaine: environ 19 millions. 650 000 / 19 000 000 = 3,4 %, soit à peu près un jeune sur trente !
Visiblement, l’expression « moins de 25 ans » est inexacte. Où est l’erreur ? Il fallait aussi fixer un seuil inférieur. L’âge de la scolarité obligatoire (16 ans) serait sans doute le meilleur. Mais admettons 15 ans, seuil le plus souvent cité. Non sans quelques observations : si l’apprentissage est ouvert dès l’âge de 14 ans, on peut donc travailler dès avant 15 ans, y compris en France. Peut-on chômer ? Admettons que non, mais cette question à elle seule mériterait débat, ne serait-ce que parce que les moins de 15 ans sont nombreux à travailler de par le monde.
(...)
Suite